150 ans depuis Jennie Trout : pionnière de la médecine au Canada
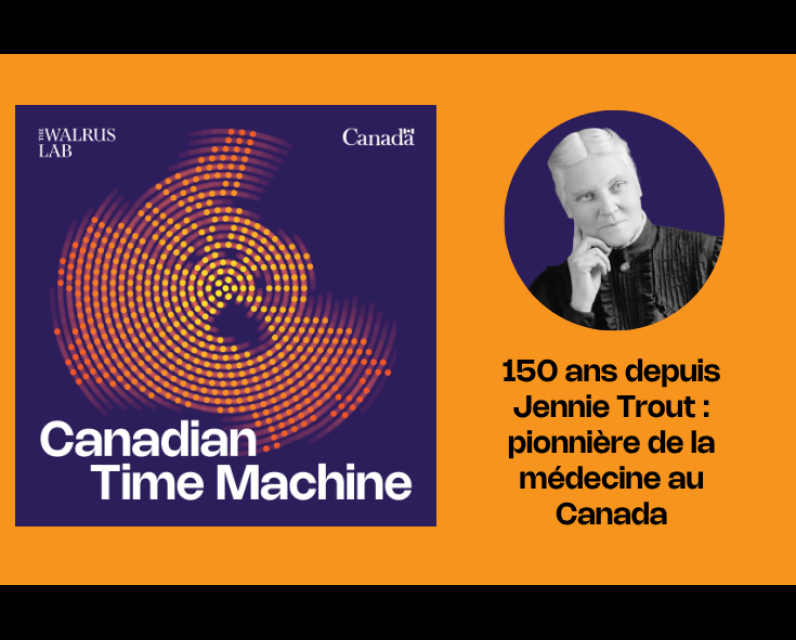
Dans cet épisode de Canadian Time Machine, nous célébrons les 150 ans depuis que Jennie Trout a ouvert la voie aux femmes dans la médecine canadienne, devenant la première femme autorisée à exercer dans le pays. L’historienne Heather Stanley revient sur son combat pour l’éducation et l’égalité, tandis que la Dre Ramneek Dosanjh, médecin et militante pour l’équité en santé, explique comment cet héritage continue d’inspirer et de transformer la profession. Ensemble, elles retracent l’impact durable d’une pionnière dont la détermination a façonné un siècle et demi de progrès en médecine au Canada.
Listen to the episode:
Angela Misri: En 1875, Jennie Trout est devenue la première femme autorisée à pratiquer la médecine au Canada — à une époque où les femmes ne pouvaient même pas voter, où les universités leur fermaient les portes des amphithéâtres, et où l’idée même d’une femme médecin faisait rire. Jennie Trout a refusé d’abandonner. Elle est partie étudier aux États-Unis parce qu’aucune école de médecine canadienne ne voulait d’elle, puis elle est revenue et a ouvert une clinique à Toronto pour les femmes qui n’avaient nulle part où aller. Elle a consacré sa carrière à défendre l’accès des femmes à l’éducation, aux soins et aux occasions d’avenir. L’histoire de Jennie Trout est celle d’une femme déterminée et rebelle, mais elle pose aussi une question : que se passe-t-il une fois la porte enfin ouverte?
Bienvenue à Canadian Time Machine, un balado qui explore les grands jalons de l’histoire de notre pays. Je suis Angela Misri. Cent cinquante ans après que Jennie Trout soit devenue médecin, les femmes ne sont plus exclues des facultés de médecine. Mais les obstacles n’ont pas disparu — ils ont simplement changé de forme. Et c’est là qu’intervient la Dre Ramneek Dosanjh.
Ramneek Dosanjh: Je suis la Dre Ramneek Dosanjh. Je vis à Vancouver, en Colombie-Britannique, et je suis la mère de trois filles. Je suis médecin de famille et hospitaliste, et j’aime croire que je suis une agente de changement et de transformation.
Angela Misri: La Dre Dosanjh est médecin de famille, hospitaliste et militante pour la santé mentale des enfants et des jeunes en Colombie-Britannique. Mais son parcours en médecine n’a pas commencé dans une salle de réunion ni dans une aile d’hôpital. Il a commencé par un appel qu’elle a ressenti dès son plus jeune âge.
Ramneek Dosanjh: J’avais 12 ans lorsque j’ai commencé à faire du bénévolat à l’hôpital local. À 12 ans, j’étais une candy striper — une jeune bénévole — et j’ai pu observer la façon dont les médecins interagissaient avec les patients et la communauté. J’en suis tombée amoureuse. J’ai toujours senti que c’était une vocation. Dès mon jeune âge, je voulais aider les gens, malgré les difficultés. Et j’ai été la première dans toute ma lignée ancestrale — dans nos villages au Pendjab, en Inde, il n’y avait jamais eu de femme médecin. Ma mère n’a même pas pu aller à l’université. J’ai senti que je devais libérer ma famille par l’éducation et par cette expérience. Comme je suis née au Canada de parents immigrants, cette aventure a été fascinante, surtout grâce à ma participation à la formation médicale et à la pratique de la médecine.
Angela Misri: Même avec toute cette passion, la route n’a pas été simple. Son père espérait qu’elle devienne une femme d’affaires redoutable, et dès le début de sa carrière, elle a réalisé que les personnes qui prenaient les décisions ne représentaient pas nécessairement celles et ceux pour qui elles les prenaient.
Ramneek Dosanjh : Tout a commencé pour moi il y a plusieurs années, quand j’ai pris la parole lors d’une réunion où l’on discutait du recrutement, de la rétention et de la planification de la relève des médecins de famille. J’écoutais cette réunion, et, sans vouloir être âgiste, la moyenne d’âge autour de la table dépassait largement les 60 ans. Alors j’ai simplement demandé : c’est intéressant que vous preniez des décisions pour des gens qui, à ce moment-là, ne seront peut-être même plus en pratique, mais où sont les étudiantes et étudiants en médecine, les résidentes et résidents, les voix de celles et ceux qui devraient être ici pour vous dire comment ils veulent exercer? Je crois qu’il faut créer une culture de soins de santé où nos prestataires sont eux-mêmes en santé — des médecins en bonne santé créent des patients en bonne santé. Et si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, si nous manquons d’autocompassion et de conscience de soi, nous continuerons à perpétuer les biais en médecine et la mauvaise gestion des soins à nos patients. Mais lorsque nous savons mieux, nous faisons mieux. Et cela, ultimement, peut améliorer l’ensemble de la société canadienne.
Angela Misri: Le soutien et le mentorat ont été essentiels, mais pour la Dre Dosanjh, le plus grand défi a été de naviguer à travers les obstacles systémiques qui existent depuis l’époque où la Dre Jennie Trout pratiquait la médecine.
Ramneek Dosanjh: Cette lutte pour comprendre ce que cela signifie d’être une femme en médecine — le sexisme, la misogynie, le patriarcat et toutes leurs couches — s’est manifestée plus tard, au cours de ma carrière de leader, quand j’ai vraiment ressenti le poids du manque de représentation. Beaucoup de personnes m’ont contactée, y compris des étudiantes et étudiants, ainsi que des collègues, pour me dire à quel point ils étaient fiers de moi, ou qu’ils se sentaient représentés. Je ne comprenais pas vraiment l’ampleur de ce que cela signifiait.
En 2022, j’ai été la première femme pendjabie de l’histoire à devenir présidente de Doctors of BC, une association provinciale qui défend les intérêts des médecins, des patients et d’un meilleur système de santé. Je suis aussi devenue la 92e présidente de la Fédération des femmes médecins du Canada. Et je leur ai dit : je ne sais pas si je suis votre présidente ou si je mérite ce rôle. Laissez-moi d’abord prononcer mon allocution d’ouverture, et voyons si cela vous parle.
J’ai parlé d’équité entre les genres, d’équité en santé et d’équité raciale. J’ai cité plusieurs de mes figures préférées — Toni Morrison, bell hooks, June Jordan — en parlant des mouvements des droits civiques et de l’importance de l’intersectionnalité dans notre travail. J’ai insisté sur l’intention délibérée d’utiliser des cadres intersectionnels pour améliorer les résultats de notre système de santé. Même pour les femmes en médecine, la représentation n’était pas aussi diversifiée que je l’aurais espéré, même après plus de cent ans. Mais à l’échelle du pays, la situation était semblable.
Une de mes expressions favorites est : le statu quo doit disparaître. Et ce jour-là, tout le monde s’est levé — certaines personnes sont même montées sur les chaises, les tables tremblaient — et toutes se sont engagées à agir. Je me suis dit : c’est exactement là que je dois être, et c’est la direction dans laquelle je dois aller. Nous devons absolument mobiliser et motiver les femmes en médecine.
Angela Misri: C’est dans ces postes de leadership qu’elle a commencé à comprendre à quel point la représentation peut être puissante.
Ramneek Dosanjh: Notre organisation existe depuis presque 102 ans, et elle a été bâtie grâce aux femmes médecins pionnières qui ont ouvert la voie. Ce sont elles qui ont permis qu’aujourd’hui, nous ayons plus de femmes que jamais diplômées en médecine. Pourtant, les postes de direction les plus élevés — les postes de doyens, les rôles décisionnels, les positions de pouvoir — ne sont toujours pas équitables. Nous savons que les femmes médecins n’obtiennent pas autant de ressources ni de temps que leurs collègues masculins. Nous savons aussi que les tâches qui leur sont confiées ne sont pas les mêmes, et cela se manifeste à de nombreux niveaux, y compris dans les cas de harcèlement sexuel ou dans l’accès aux occasions professionnelles. Trop souvent, nos collègues masculins cherchent à se faire remplacer par d’autres hommes, rarement par des femmes, encore moins par des femmes racisées.
Il faut que l’échelle de progression et la diversité de la représentation reflètent la réalité des patientes et patients que nous servons. Et la diversité du leadership en médecine n’aide pas seulement les femmes médecins à mieux naviguer dans leur carrière — elle est aussi essentielle pour améliorer notre capacité à soigner toutes les personnes, dans toute leur complexité et leur diversité. Depuis des décennies, nous voyons la discrimination et les biais dans la recherche médicale, et nous extrapolons ces résultats à toute la population. Mais c’est inexact. Cela ne tient pas compte des expériences vécues, ni de l’intersectionnalité, qui est pourtant essentielle lorsque nous considérons nos patients, nos données, nos traitements, nos innovations et nos progrès en médecine. En ce moment, nous peignons tout le monde avec le même pinceau sur la même toile — et c’est faux.
Angela Misri: Nous avons parcouru un long chemin depuis 1875, mais la Dre Dosanjh croit qu’on peut faire encore mieux.
Ramneek Dosanjh: Je pense que nous devrions être bien plus avancés que nous le sommes, parce que nous sommes prêts pour une véritable transformation. Cela dit, je reconnais et j’apprécie les progrès graduels réalisés — le fait que nous ayons plus de femmes que jamais diplômées en médecine est un accomplissement énorme, et cela n’a pas toujours été le cas. Donc oui, je salue tous ceux et celles qui ont ouvert ces portes. Mais sommes-nous allés assez loin? Non. La réponse est non, parce que nous n’avons pas encore atteint les objectifs d’équité en santé, qui incluent aussi les piliers de l’équité des genres et de l’équité raciale. Tant que nous n’y serons pas, notre travail ne sera pas terminé. Mais je crois que nous entrons dans une nouvelle ère de conscience et de changement culturel.
Angela Misri: La Dre Dosanjh croit qu’on ne peut pas avancer vers une véritable équité sans apprendre de celles et ceux qui ont été historiquement exclus de la médecine.
Ramneek Dosanjh: J’ai énormément appris ces dernières années grâce à mes aînés et collègues autochtones, ainsi qu’à mes collègues noirs. L’intensité de leur douleur, la profondeur de leur engagement et de leur raison d’être sont bouleversantes et inspirantes. Quand je les observe, j’admire leur patience et je célèbre le chemin qu’ils ont parcouru. C’est ce qui me pousse à rester inébranlable dans ma quête d’équité en santé. Ces leaders incroyables, malgré tous les obstacles et les barrières, continuent d’avancer avec une passion tenace et courageuse pour provoquer le changement. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Nous devons nous aussi être présents.
Angela Misri: Et si Jennie Trout était parmi nous aujourd’hui, la Dre Dosanjh aimerait lui dire ceci :
Ramneek Dosanjh: Sans vous, je n’existerais pas. Sans vous, nous n’aurions pas de levier. Sans votre courage à abattre ce mur, nous n’aurions pas évolué de façon aussi magnifique. Je ne crois pas qu’aucun secteur devrait être homogène. Nous devrions y parsemer des diasporas, partager notre sagesse collective pour vraiment transformer la vie des autres — et la nôtre aussi. On n’a qu’une vie, une seule chance. Inutile d’être en colère : si vous l’êtes, transformez cette colère en action. Faites-en quelque chose de positif. Ne laissez pas le monde défiler sous vos yeux. Chaque petit geste peut faire une différence.
Angela Misri: Le parcours de la Dre Dosanjh montre à quel point l’héritage de Jennie Trout résonne encore aujourd’hui. Les portes qu’elle a ouvertes il y a 150 ans continuent de façonner des vies, d’inspirer des leaders et de faire progresser la médecine vers plus d’équité et d’inclusion. Mais à quels défis Jennie elle-même a-t-elle dû faire face? Que signifiait, concrètement, pour une femme de franchir le seuil d’une salle de classe de médecine dans les années 1870? Pour mieux comprendre le chemin parcouru dans la médecine canadienne, nous accueillons Heather Stanley, professeure agrégée à l’Université de Lethbridge et ancienne présidente du Comité canadien de l’histoire des femmes.
Bonjour Heather, merci d’être avec nous.
Heather Stanley: Bonjour, ravie d’être ici.
Angela Misri: D’accord, Heather, pouvez-vous nous ramener à l’époque dans laquelle Jennie Trout a évolué? À quoi ressemblaient la médecine et la formation médicale pour les femmes au Canada au XIXᵉ siècle?
Heather Stanley: En ce qui concerne la formation médicale, elle n’existait pratiquement pas. Jennie, comme d’autres femmes de son époque qui voulaient étudier la médecine, devait la plupart du temps aller aux États-Unis, puisque aucun collège canadien n’acceptait les femmes. On voit donc des femmes comme Jennie partir aux États-Unis — elle est allée en Pennsylvanie — pour y faire leurs études, puis revenir au Canada pour exercer. Mais elles se heurtaient à de nombreux obstacles, et c’est pour cela que Jennie est une « première » aussi marquante. L’éducation des femmes ne leur permettait pas d’acquérir certaines connaissances essentielles pour entrer à l’école de médecine, même si une telle école avait existé. Par exemple, il fallait connaître le latin pour y être admise, et cette langue n’était presque jamais enseignée aux jeunes filles.
Pour beaucoup de familles — sauf les très riches, ou celles qui, pour diverses raisons, croyaient à l’importance de l’éducation des femmes —, l’éducation féminine était considérée comme un luxe, un supplément agréable si on pouvait se le permettre, mais certainement pas une priorité. Obtenir une éducation suffisamment avancée pour entrer à l’école de médecine était donc extrêmement difficile pour une femme.
Angela Misri: Que savons-nous de Jennie Trout elle-même? Qu’est-ce qui l’a poussée à se lancer en médecine à une époque où les femmes en étaient largement exclues?
Heather Stanley: Nous ne savons pas énormément de choses sur Jennie Trout. Nous aurions d’ailleurs besoin de biographies actualisées à son sujet. Nous savons qu’à un moment donné, elle a souffert d’un trouble nerveux — un terme très vague qui pouvait englober beaucoup de choses — et qu’elle a suivi un traitement par électrothérapie. Là encore, c’est un terme flou qui recouvrait diverses pratiques. À cette époque, l’électricité était encore nouvelle et fascinante, et on commençait à l’utiliser en médecine, notamment pour traiter les troubles mentaux.
Jennie a suivi ce traitement, elle a affirmé qu’il l’avait guérie, et elle a décidé de consacrer sa vie non seulement à la médecine, mais particulièrement à cette approche thérapeutique — que nous considérerions aujourd’hui comme marginale — mais à laquelle elle croyait fermement. Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé, mais les changements dans les mentalités se faisaient lentement et graduellement. Nous ignorons quelles conversations ont pu se tenir autour de la table familiale pour la convaincre que cela était possible.
Nous savons qu’Emily Stowe, contemporaine de Jennie Trout, s’est engagée dans le mouvement pour le droit de vote des femmes, ce qui montre bien qu’il y avait une conscience politique autour de ces enjeux. Comme on disait à l’époque, l’éducation des femmes était un « luxe », et pour aller étudier aux États-Unis, il fallait avoir un revenu disponible. Jennie l’a fait après son mariage, et son mari l’a soutenue dans cette démarche, ce qui était rare. Jennie voulait vraiment favoriser la formation médicale et soigner des femmes comme elle — c’est ce qui l’a poussée.
Angela Misri: Donc, c’est un ensemble de facteurs qui s’entrecroisent — elle suit ce traitement qui l’aide, cela l’inspire, et elle se dit : je veux faire quelque chose dans ce domaine. C’est fascinant, le parcours qu’elle a suivi pour en arriver là. Alors, quels obstacles a-t-elle rencontrés une fois admise à l’école de médecine? Nous avons parlé du latin, des enjeux financiers, et du fait qu’il était mal vu, culturellement et socialement, pour une femme d’aller étudier la médecine aux États-Unis. Mais concrètement, quels autres obstacles a-t-elle affrontés pendant ses études, et comment les a-t-elle surmontés?
Heather Stanley: Nous savons donc que les écoles de médecine n’étaient pas particulièrement enthousiastes à l’idée d’accueillir des femmes. Et c’était une période cruciale pour la médecine et les médecins. L’époque victorienne, dans laquelle nous nous trouvons, est celle où les médecins victoriens consolident réellement leur profession. Ils ont travaillé énormément pour passer de ce qui était considéré presque comme un métier manuel — parce qu’ils travaillaient de leurs mains — à une profession que les gentlemen poursuivent. Ils voyaient les femmes comme une menace, parce que si elles pouvaient le faire, la profession resterait-elle respectable et académique ?
On observe cela par exemple avec les médecins et infirmières de l’époque : ils étaient satisfaits de l’idée de l’infirmière hospitalière, vue comme subordonnée, très féminine, correspondant à l’idéal victorien de la femme soignante. Les femmes étaient donc confrontées à une hostilité active, et les instructeurs aussi. On leur faisait des farces, on essayait de les choquer, de les faire s’évanouir en leur montrant des cadavres, ce qui était assez courant dans toutes les écoles de médecine. Cette hostilité se retrouvait également dans d’autres domaines, comme l’entrée des femmes dans la profession juridique.
Pour devenir médecins autorisées, Emily Stowe et Jennie Trout devaient compléter une partie de leur formation au Canada, même si elles avaient été formées aux États-Unis, et réussir les examens de fin d’études canadiens. Cela représentait un énorme obstacle, car les États-Unis étaient plus libéraux dans certains endroits concernant l’accès des femmes à l’enseignement supérieur, tandis que de nombreuses universités canadiennes établies n’étaient pas intéressées. Elles devaient donc revenir au Canada pour étudier, où elles étaient harcelées : on leur criait dessus, les instructeurs refusaient de les enseigner correctement ou de leur fournir les mêmes documents. On mettait autant d’obstacles que possible devant elles, car leur présence était perçue comme dévalorisante pour la profession.
Angela Misri: Il y a presque cinq ans d’écart entre la fin des études de Trout et celles de Stowe. Pendant presque cinq ans, elle est littéralement la seule femme médecin canadienne. Quel effet d’entraînement cela a-t-il eu ? Ces deux femmes devaient affronter tous les obstacles, un peu comme l’aînée dans une famille, qui doit tout faire en premier et se battre pour tout.
Heather Stanley: Oui. Et malgré tous les abus, elle refuse de céder : elle dit qu’elle ne passera pas l’examen de fin d’études, qu’elle pratique sans licence et qu’on ne peut pas l’arrêter. C’est la détermination de Jennie. Ce qui est intéressant, c’est que leurs personnalités suivent en partie le même parcours pour devenir les premières femmes médecins. Stowe est un peu plus militante, tandis que Jennie, motivée par le désir de rendre ce traitement accessible aux femmes, passe silencieusement les examens et devient la première femme médecin sans beaucoup de tapage médiatique.
Ainsi, elle devient la première femme médecin licenciée au Canada. L’effet d’entraînement est difficile à mesurer dans l’esprit des gens, mais votre analogie avec l’aînée est pertinente : il est plus facile de suivre le chemin tracé par quelqu’un, même s’il n’y a qu’une seule personne, ici Jennie Trout. Ensuite, Stowe la rejoint après une certaine distance entre elles, et elles apportent des changements concrets qui facilitent l’accès des femmes à l’éducation au Canada. Elles planifient ensemble la création d’un collège-hôpital pour femmes, établissant une filière éducative séparée pour elles.
C’est intéressant, car après avoir subi moqueries et humiliations, leur solution est de séparer l’enseignement des femmes. Elles avaient enduré tant de vitriol de la part de leurs collègues masculins et professeurs. Initialement prévu à l’Université de Toronto, le projet est retardé car Stowe est occupée ailleurs, alors Jennie Trout va à Queen’s, puis Stowe crée son établissement à l’Université de Toronto, et les deux filières fonctionnent parallèlement — problématique car peu d’étudiantes peuvent intégrer ces programmes. Finalement, elles fusionnent, et Jennie contribue également à la création du women’s dispensary, qui ouvre en 1898 et permet aux femmes de pratiquer et de se former au Canada. Elles peuvent y occuper des postes de direction, apprendre l’administration et se former concrètement.
Le revers de la médaille, c’est que cette séparation crée un système parallèle : les femmes peuvent devenir médecins, mais elles sont confinées à la médecine pour femmes et enfants. Cela renforce l’idée victorienne selon laquelle la femme médecin est plus douce pour traiter les enfants et les patientes, mais marginalise leurs possibilités dans d’autres domaines de la médecine. C’est donc un double tranchant.
Angela Misri: Oui, et quand on regarde les luttes de ces premières femmes — celles qui ont ouvert la voie, quitté la médecine pour se concentrer sur l’éducation d’autres femmes et créer des pratiques accessibles aux femmes formées à cette époque — voyez-vous des parallèles avec aujourd’hui, concernant les obstacles rencontrés par les femmes?
Heather Stanley: Je pense que de nombreux obstacles persistent pour les femmes médecins. L’un de mes soucis quand on parle des « célèbres premières » est que ces femmes blanches privilégiées ont souvent bénéficié d’avantages qui se sont faits au détriment d’autres femmes : les femmes racisées, les femmes issues de minorités ethniques, les femmes pauvres. Oui, Jennie Trout voulait soigner ces femmes à moindre coût et a ouvert ces portes, mais elle s’en servait aussi comme patientes pour apprendre. Beaucoup de travail des femmes se fait donc en coulisses. Si vous êtes l’une de ces « célèbres premières », il y a probablement quelqu’un pour entretenir votre maison qui, financièrement et socialement, n’a pas les mêmes moyens pour devenir une pionnière célèbre. Il est donc important d’en parler, surtout quand on voit des femmes comme Emily Stowe liées au mouvement pour le suffrage, qui au Canada comporte des associations problématiques avec, par exemple, l’eugénisme. Jennie Trout, elle, a mis en place tout ça, puis s’est retirée pour se concentrer sur sa pratique. Elle est donc moins problématique que certaines autres. Mais il faut reconnaître l’ampleur de ce qu’elles ont accompli et être conscient que tout le monde n’a pas les mêmes ressources.
Angela Misri: C’est intéressant : j’ai regardé, la première femme médecin originaire d’Inde a étudié à la même université de Pennsylvanie en 1886. Donc cela se produisait, lentement, dans différentes parties du monde. Mais cet hôpital de Pennsylvanie a formé de grands noms, non? C’est quand même un fait marquant.
Heather Stanley: C’est vraiment intéressant. Et je me demande ce qui, à cet hôpital de Pennsylvanie, a permis d’ouvrir ces portes.
Angela Misri: Merci beaucoup d’avoir discuté avec nous aujourd’hui, Heather.
Heather Stanley: Merci beaucoup de m’avoir invitée.
Angela Misri: Merci d’avoir écouté Canadian Time Machine. Ce balado reçoit un financement du gouvernement du Canada et est créé par The Walrus Lab. Cet épisode a été produit par Jasmine Rach et monté par Nathara Imenes. Amanda Cupido est la productrice exécutive. Pour d’autres histoires sur les jalons historiques canadiens et les transcriptions en anglais et en français de cet épisode, visitez walrus.ca/canadianHeritage. Il existe également un pendant francophone de ce balado intitulé Voyages dans l’histoire canadienne. Donc si vous êtes bilingue et que vous voulez en écouter davantage, vous pouvez le trouver là où vous obtenez vos balados.
The post 150 ans depuis Jennie Trout : pionnière de la médecine au Canada first appeared on The Walrus.



Comments
Be the first to comment